PROFILS DE CHINEURS
« Aux fêtes des puces, on a vu Robert Hue chiner en riant. »
L’Album de la Comtesse
A l’ombre des platanes parisiens ou des tours d’HLM de banlieue, il fait si bon chiner dans les brocantes et autres vide-greniers ! Surtout par le joli printemps que voici… Mais la saison touche bientôt à sa fin, et je vous propose de passer rapidement en revue quelques uns des joyeux chineurs qui traînent encore leurs basques entre les stands.
[Passons rapidement sur les marchands qui hantent la place dès les cinq heures du mat’ et dont j’ai déjà parlé ailleurs].
Voici donc quelques autres personnages que vous ne manquerez pas de rencontrer.
Le passionné de militaria : il achète systématiquement tout objet ou effet arborant l’élégante et bien caractéristique couleur vert-kaki. « Ouah, une gourde militaire de l’armée (sic.) ! C’est combien ? » Notez bien qu’il en a déjà accumulé une cinquantaine du même modèle au cours de ces trois dernières années, mais peu importe.
Le curieux casse-pieds qui touche à tout, examine à la loupe le cul de chaque bibelot, demande tous les prix, renifle, compare, estime, hausse un sourcil perplexe et, bien sûr, n’achète rien.
Le néophyte qui n’en croit pas ses yeux de tomber sur un exemplaire de Tintin au Pays des Soviets pour seulement 10 € « Bigre, la chance que j’ai : personne ne l’a vu avant moi ! Et en bon état en plus ! Niark-niark, je vais refourguer ça sur eBay, ma fortune est faite… » Sauf qu’il s’agit évidemment d’un fac-similé de l’édition de 1930, etc.
Le spécialisé, atteint de collectionnite aigüe : celui-ci n’achète que des monnaies françaises. Bon, là, c’est compréhensible ; mais un jour, j’ai rencontré un gars qui parcourait les stands à la recherche de « tickets de tramway de la banlieue de Buenos Aires émis entre 1909 et 1913 – neufs de préférence ». « Vous n’en avez pas ? Non ? » Et il s’en allait penaud, le dos courbé, déçu que personne ne comprenne sa passion…
Le couple de bobos trentenaires en balade et qui encombre le passage avec sa poussette (on se demande ce qu’ils viennent foutre ici. Seraient bien mieux aux Buttes Chaumont ou au parc de Sceaux).
L’écrémeur : si vous avez le malheur de passer après lui, il ne reste que les miettes. Il a le don agaçant de vous précéder d’une demi-seconde sur les stands, de s’accaparer une boîte en fer pleine de monnaies (la seule dans toute la brocante) et de prendre tout son temps à passer en revue chaque pièce sous votre regard rageur. Inutile d’espérer glaner quoi que ce soit après le passage de ce salopard. Et le pire c’est qu’on ne peut même pas rouspéter, car il y a des règles dans cet univers impitoyable : dès lors qu’un lot est entre les mains d’un potentiel acheteur, celui-ci la priorité sur la vente. Or, contrairement au commerce traditionnel, chaque article n’existe ici qu’en un seul exemplaire…
Le snob, quant à lui, aime « se faire plaisir » ; il paye rubis sur l’ongle, sans marchander (c’est d’un vulgaire), des bouquins qu’il ne lira jamais ou encore quelque babiole parfaitement inutile, mais dont la vue le désennuiera quelques heures durant l’après-midi du dimanche, et qui finira oubliée au fond d’un tiroir.
Et puis il y a enfin l’éternel chineur insatisfait, aussi désabusé qu’abruti, rechignant à tirer quelques pièces de sa poche pour s’offrir la bricole dont il meurt d’envie, mais qui n’hésite pas à s’en aller flamber un billet de 10 € à la brasserie du coin en s’octroyant un demi en terrasse et un paquet de blondes (respectivement 3,50 et 6,50 €).
La liste n’est pas exhaustive : n’hésitez pas à dénoncer ceux que j’ai oubliés !

En pleine négociation. Je vous laisse deviner lequel de ces personnages est en train de faire une bonne affaire…











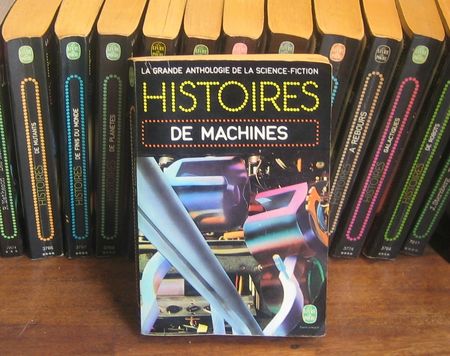












/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F8%2F982159.jpg)